Je suis convaincu, peut-être sans raison, que pour mieux apprécier une œuvre il est impératif d’être conscient des défauts et problèmes qui peuvent insupporter ceux qui la détestent. Prenons un exemple évident, pour doser son appréciation, un bon amateur de Kaamelott, par exemple, doit avoir une part de lui-même capable de haïr les tics de la série.
Et s’il est plus courant aujourd’hui que les éditeurs, critiques et traducteurs couvrent de louanges les œuvres médiévales arthuriennes dont ils s’occupent, à grands renforts de comparaisons à l’Illiade ou Cervantès, afin d’attirer le public sur leur valeur artistique, je dois avouer avoir un faible pour l’âge héroïque de la fin du XIXème siècle au début du XXème, où les spécialistes avaient plutôt tendance à en tirer des portraits impitoyables. Certains y restent fidèles (l’éditeur d’un texte m’a soufflé qu’il n’envisageait pas lui-même de le traduire car il donnerait une mauvaise image de la littérature médiévale) mais essayons d’en rassembler des exemples classiques ici.
Paulin Paris sur le Livre d’Artus contenu dans le manuscrit BnF fr. 337 :
Mais, à compter de là, le copiste fait route à part au lieu de suivre le roi Loth dans son intéressant voyage, il nous retient devant Clarence et nous raconte avec une prolixité désespérante tous les détails de la victoire remportée sur les Saisnes.
Paulin Paris, Les romans de la Table Ronde (1868)
Gaston Paris sur le début du Tristan en prose :
Tous les manuscrits qui contiennent le prologue où ce soi-disant chevalier anglais, seigneur d’un château près de Salisbury [Luce du Gast], parle si allègrement de lui même à la première personne, le font suivre d’une introduction, aussi ennuyeuse que longue et inutile, sur les ancêtres de Tristan, farcie de réminiscences mythologiques, et de fictions d’une monotone absurdité.
Gaston Paris, « Note sur les romans relatifs à Tristan » (1886)
Effectivement, on imaginerait que les affrontements entre les dynasties entremêlées de la Cornouailles et du Léonnois seraient un prélude de la guerre entre Marc et Tristan, mais le long prologue se conclut par un saut dans le futur, une coupure où on nous dit simplement « quelques générations se succédèrent et puis on arrive à Marc et Tristan ! Même les analystes qui prétendent que ce long prologue augure les thèmes du roman le font d’un ton très peu convaincu.
Dans son panorama des romans de la Table Ronde pour l’Histoire littéraire de la France, Gaston Paris ne lésine pas. Sur ces romans en général, son diagnostic est d’emblée sévère :
« Cette « vanité », cette absence complète de sérieux et de suite, cet enfilement incohérent d’aventures entreprises sans motifs, dont l’extravagance va souvent jusqu’à la plus complète absurdité étaient ce qui plaisait alors ; c’est ce qui nous lasse aujourd hui dans la lecture de ces poèmes dont le monde factice à la fois dénué de vraisemblance et de variété (car toutes ces aventures se ressemblent et sont souvent copiées les unes sur les autres) nous inspire vite, en même temps que l’ennui, le désir de nous reposer avec quelque réalité vivante. » (p. 16)
En plus d’éditer le Cligès de Chrétien de Troyes, « M. Förster […] publie en appendice une très médiocre rédaction en prose que ce poème a subie au XVe siècle. » (p. 26)
Sur Hunbaut : « Ce poème, très médiocre tissu d’aventures banales ne nous est parvenu qu’incomplètement dans le manuscrit souvent cité de M. le duc d’Aumale […] » (p. 61)
Sur Blandin de Cornouailles : « Ce roman fort médiocre a été imprimé en 1873 par M. Paul Meyer […] » (p. 121)
Il en profite pour tacler les collègues :
« Le volume des Mémoires de l’Académie de Turin auquel renvoie l’article de l’Histoire littéraire est mal indiqué il s agit du tome XXVII deuxième partie dans lequel on se borne d ailleurs à indiquer une notice manuscrite de M. Portalis des Luckets sur ce roman. Cette notice a été récemment retrouvée à Turin elle a perdu tout intérêt depuis la publication du texte. Elle est faite, paraît-il, très consciencieusement. » (Ibid.)
Il inculpe longuement Méraugis de Portlesguez pour ses manquements :
« On peut louer, dans son ensemble, la composition du roman de Méraugis. Elle est sujette, cependant, à un assez grave reproche. Le poète a des idées qui prêter à de très intéressants développements et il n en tire pas parti. On a souvent, et souvent à tort, voulu chercher des idées profondes cachées sous la suite peu liée d’aventures invraisemblables qui composent la plupart de nos romans celui-ci paraît bien avoir été réellement conçu en vue de mettre une idée en action: lequel a raison des deux amants qui aiment la même femme l’un pour ses charmes physiques, l’autre pour ses qualités morales ? Le problème est vivement et nettement posé au début, mais il n’est ni résolu, ni même sérieusement abordé : la discussion de la cour des dames est insignifiante et les actions des deux rivaux qui devraient toutes être inspirées par leur conception différente de l’amour n’ont plus aucun rapport avec ce point de départ. Il en est de même de la résolution prise par Lidoine d’accompagner Méraugis dans sa quête de Gauvain : on s’attend à ce que la présence inaccoutumée d’une femme dans un voyage de ce genre va produire des épisodes d’un caractère particulier mais on est complètement déçu : les aventures se succèdent sans que Lidoine y ait la moindre part sans même d’ordinaire qu’elle y soit mentionnée et le poète semble oublier sa présence aussi complètement que le héros lui-même quand celui-ci combine, en prenant si peu souci de sa maîtresse, son évasion de la Cité sans nom. Ç’aurait été le cas cependant de mettre en lumière par quel que trait frappant cette « valeur » de Lidoine supérieure à sa beauté qui lui vaut l’amour de Méraugis et que nous sommes réduits à admettre sur parole tant sa figure sort peu de la banalité coutumière des figures de femmes dans nos romans. Ce contraste entre l’originalité de la conception et la faiblesse de l’exécution est frappant : il montre en Raoul comme les disparates de sa manière, comme cet emploi poussé jusqu à l’abus et tombant dans l’enfantillage de la forme interrogative, comme la vivacité même et la coupe hachée de son style et de son vers, une nature ardente mais peu tenace toute à l’impression du moment tantôt jetant ses idées et ses paroles comme elles lui viennent sans les trier ni les suivre tantôt s’attachant avec une attention excessive et minutieuse à raffiner sur un détail de pensée ou d’expression ; nature intéressante, en somme, richement douée pour certains côtés de la poésie et qui aurait sans doute produit des œuvres vraiment remarquables si elle avait été plus sagement et plus sévèrement gouvernée. » (pp. 235-7)
Félix Bellamy sur la Suite Post-Vulgate du Merlin :
« J’abrège un peu le récit en élaguant çà et là des longueurs et des détails inutiles ou sans importance »
« […¨] maintes aventures qui sont moins que intéressantes, le contraire même d’intéressantes »
Bellamy, La forêt de Bréchéliant (1896), II.518.
Pour reprendre le résumé de Bruce en 1923, dans un livre de référence, la Suite-Vulgate du Merlin (dont on fait tout un foin à chaque fois qu’un fragment se rajoute à nos quarante manuscrits) est :
« […] pour la plus grande partie faite de descriptions interminables de guerre entre Arthur et ses barons rebelles, ou entre Arthur et les Saxons ou entre les barons rebelles et les Saxons. » (traduction personnelle)
« la portion la plus terne et la moins imaginative de tout le cycle de la Vulgate [donc le Lancelot-Graal] »
Bruce, The Evolution of Arthurian Romance, 1923:I.395 et I.397.
Sur le Perceforest (plus long roman en moyen français) :
« Perceforêt est le plus vaste des romans que nous ait laissés le moyen âge […] et en même temps, peut-être, la plus ennuyeuse de toutes ces compositions. [Sauf quelques épisodes tout y est] d’une monotonie désespérante. »
L.-F. Flutre, « Etudes sur le roman de Perceforêt » (1948)
Madeleine Tyssens, La geste de Guillaume d’Orange (1967) : l’épisode arthurien de la Bataille Loquifer est une « détestable invention » (p. 274) insérée dans une chanson qui est déjà « la plus médiocre du cycle, assurément » (p. 265) — citée par Trachsler, Disjointures-Conjointures, p. 176.
(À étendre à l’avenir.)
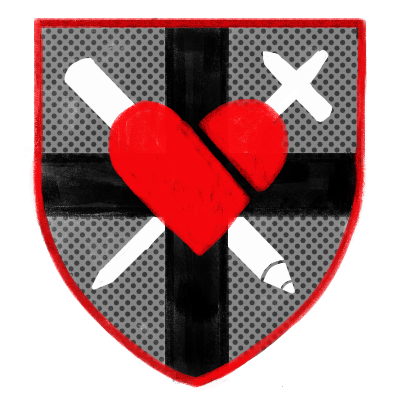

Laisser un commentaire