« Nous tirerons l’épée là-bas, sur le sable que couvre la marée, et qui, six heures par jour, est le territoire de la France, mais pendant six autres heures le territoire de Dieu. »
(Le Vicomte de Bragelonne, chap. XCIV, “Une foule de coups d’épée dans l’eau”)
Je voulais profiter d’avoir enfin fini d’illustrer cette trilogie après quatre ans pour dire un mot dessus. Bien que son roman de 1844, Les Trois Mousquetaires, soit peut-être le l’oeuvre la plus connue de Dumas, les deux suites qu’il lui écrivit sont moins lues, marquent moins la mémoire — cependant je les aime beaucoup pour la mise en perspective qu’ils accomplissent — au-delà de leurs qualités littéraires que j’apprécie déjà.
Vingt Ans Après (1845) est situé un nombre d’années après les évènements du premier livre que vous pouvez deviner. Tout le monde, sauf D’Artagnan qui reste coincé aux mousquetaires, s’est mu vers des échelons plus élevés de la société. Les anciens camarades soient divisés par la Fronde et par la Guerre Civile Anglaise : D’Artagnan et Porthos sont envoyé en mission auprès de Cromwell par Mazarin ; Athos et Aramis auprès de Charles Ier par Lord de Winter et Henriette Marie de France, et contre Mazarin ces deux joignent la Fronde. Ils vont cependant s’allier pour secourir Charles Ier et contrer Mordaunt, le fils de Milady qui cherche à se venger et à déjà tué le bourreau de Béthune. Au-delà du motif des vieux roublards qu’on sort de leur routine pour une dernière aventure (peut-être une innovation d’ailleurs ?) c’est un roman plus complexe que le rouleau compresseur de cape et d’épée des Trois Mousquetaires et son vernis de noblesse.
Disons, le succès et le charme des Trois Mousquetaires dépend malheureusment de ce qu’on soit aveuglé par sa longue chevauchée. Mais si on s’arrête pour s’interroger sur les fondements moraux de l’action de nos supposés paladins désargentés, on est perplexe. Qu’est-ce qui justifiait que D’Artagnan viole Milady en prenant la place de De Wardes dans l’obscurité ? Certes, Dumas fait l’effort ensuite d’empiler les péchés de cette femme pour qu’on la méprise assez et ne s’interroge pas, mais il le fait maladroitement.
- Elle fait certes partie du plan de Richelieu pour perdre Anne d’Autriche en montrant qu’elle avait offert un bijou confié par le Roi au Duc de Buckingham, pour que le roi perde confiance en elle et pense qu’elle le trompait. Mais… En fait c’est vrai. Milady ne fait que participer à le révéler, tandis que les Mousquetaires aident à protéger disons sa vie privée de cette indiscrétion.
- On apprend qu’elle était la femme d’Athos, et qu’elle l’avait trahie, ou plus exactement qu’il la pensait morte, parce qu’il l’avait pendue de ses mains quand il avait vu sur son épaule une fleur de lys, marque infamante, car » la pauvre fille avait volé les vases sacrés d’une église » (chap. XXVII)
- Et pourquoi avait-elle été condamnée ? Eh bien en fait elle ne l’a pas vraiment été. Comme le raconte le bourreau (chap. LXV) quand elle était encore Anne de Breuil, elle avait défroqué un prêtre, frère du bourreau, en le séduisant, et c’est ce prêtre qui avait ensuite volé des vases sacrés. C’est le scénario d’un homme vertueux perdu par une femme de mauvaise vie, mais c’était un grand garçon, libre de ses moyens. Milady s’enfuit en séduisant le fils du geôlier, donc le bourreau la traque et lui imprime la même marque qu’au prêtre, sans véritable décision de justice. Pourquoi serait-elle véritablement jugée coupable alors que le bourreau lui-même avoue que c’est son frère qui a subtilisé les vases (« Le prêtre vola les vases sacrés, les vendit »). Athos a donc tenté de la tuer pour une marque de justice qui a été imposée dans un contexte peu clair.
- Elle a exhorté Felton (chap. LII à LVII) a tuer Buckingham (chap. LIX) en attisant sa ferveur religieuse. C’est relativement moins insidieux, puisque Felton est historiquement l’assassin de Buckingham, il était difficile de l’impliquer plus directement, mais ça me semble difficile, surtout comme elle était en captivité, de lui attribuer ce crime, même sur le plan de la complicité. En outre elle obtient sa sympathie par leur foi catholique partagée et en lui racontant qu’elle a été persécutée par des hommes (chap. LVII), ce qui est objectivement vrai ?
- Elle aurait empoisonné le frère de Lord de Winter « mort en trois heures d’une étrange maladie, qui laisse des taches livides sur tout le corps » (chap. LXV) mais qu’en sait-on ?
- Son seul vrai crime est d’empoisonner Constance Bonacieux (Chap. LXIII) petite amie de D’Artagnan, et il me semble assez évident que Dumas a ajouté ce passage car en faisant les comptes alors que la fin du livre approchait, il aurait été bien trop clair sinon que les mousquetaires avaient bien plus fait de tort à Milady que l’inverse.
Le but bien sûr c’est un personnage de femme qui corrompt les hommes par ses mensonges et manipulations, un serpent maléfique qui tente les hommes et les pousse au mal. Mais au final, dire à quelqu’un « tu devrais commettre ce crime » c’est une complicité relativement maigre. Dans la réalisation, ultimement on la rend responsable de la « perdition » du prêtre, ce qui légitime la chaîne d’événements : qu’elle soit marquée par un bourreau qui agit hors de toute juridiction pour une vengeance personnelle, puis que son mari tente de la tuer, que D’Artagnan la viole, puis qu’enfin pour le péché rajouté d’avoir tué Constance, Athos retrouve le bourreau de Lille, et sur l’autorité d’un blanc-seing de Richelieu, que toute cette clique de violeurs, meurtriers et justiciers improvisés parodient un procès avant que le bourreau ne la décapite.
C’est le centre de gravité moral de l’histoire, mais quand on lit objectivement ce qui se passe, ce qui est raconté, même sans entrer dans les topos misogynes qui en dégoulinent, on ne peut pas s’empêcher de ressentir un certain malaise devant cet achoppement.
Et je pense que Dumas (et Macquet) l’ont ressenti aussi, déjà dans la tentative d’ajouter le cadavre de Constance dans la balance, mais aussi en ce que Vingt Ans Après manifeste au grand jour le malaise refoulé par les discours des Trois Mousquetaires. Un résumé introduit Athos disant qu’il « a cessé de boire et de tuer sa femme » ce qui est sauvagement vrai.
Dans Vingt Ans Après, sur son lit de mort, le bourreau de Lille manifeste une profonde culpabilité pour ce qu’il avait fait, avant d’être tué par Mordaunt :
« — Une femme ! C’est donc une femme que vous avez assassinée ? s’écria le moine.
— Et vous aussi ! s’écria le bourreau, vous vous servez donc de ce mot qui retentit à mon oreille : assassinée ! Je l’ai donc assassinée et non pas exécutée ! je suis donc un assassin et non pas un justicier ! […]
— Horreur ! dit le moine. Et vous avez obéi ?
— Mon père, cette femme était un monstre, elle avait empoisonné, disait-on, son second mari, tenté d’assassiner son beau-frère, qui se trouvait parmi ces hommes ; elle venait d’empoisonner une jeune femme qui était sa rivale, et avant de quitter l’Angleterre, elle avait, disait-on, fait poignarder le favori du roi. […]
— Et vous l’avez tuée ! dit le moine ; vous avez servi d’instrument à ces lâches, qui n’osaient la tuer eux-mêmes ! vous n’avez pas eu pitié de cette jeunesse, de cette beauté, de cette faiblesse ! vous avez tué cette femme !
— Hélas ! reprit le bourreau, je vous l’ai dit, mon père, cette femme, sous cette enveloppe céleste, cachait un esprit infernal, et quand je la vis, quand je me rappelai tout le mal qu’elle m’avait fait à moi-même… » (chap. XXXV)
Milady est régulièrement dite démoniaque quand on aurait trop peur qu’elle soit conçue comme humaine. Grimaud recueille aussi sa confession après que Mordaunt (le faux moine) le poignarde, ce qui lui permettra d’avertir les autres mousquetaires qu’il arrive :
« — Deux jeunes gentilshommes qui se rendaient à l’armée, et dont l’un d’eux, j’ai entendu son nom prononcé par son camarade, s’appelle le vicomte de Bragelonne.
— Et c’est ce jeune homme qui vous a amené ce moine ?
— Oui.
Grimaud leva les yeux au ciel.
— C’était donc la volonté de Dieu, dit-il.
— Sans doute, dit le blessé.
— Alors voilà qui est effrayant, murmura Grimaud, et cependant cette femme, elle avait mérité son sort. N’est-ce donc plus votre avis ?
— Au moment de mourir, dit le bourreau, on voit les crimes des autres bien petits en comparaison des siens.
Et il retomba épuisé et fermant les yeux. » (chap. XXXVI)
Mais avant même qu’ils soient traqués par lui, D’Artagnan témoigne à Athos de sa culpabilité dans son assassinat :
« L’idée de milady vint se présenter à l’esprit de d’Artagnan.
— Et vous êtes heureux ? dit-il à son ami.
L’œil vigilant d’Athos pénétra jusqu’au fond du cœur de d’Artagnan et sembla y lire sa pensée.
— Aussi heureux qu’il est permis à une créature de Dieu de l’être sur la terre. Mais achevez votre pensée, d’Artagnan, car vous ne me l’avez pas dite toute entière.
— Vous êtes terrible, Athos, et l’on ne vous peut rien cacher, dit d’Artagnan. Eh bien ! oui, je voulais vous demander si vous n’avez pas quelquefois des mouvements inattendus de terreur qui ressemblent…
— À des remords ? continua Athos. J’achève votre phrase, mon ami. Oui et non, je n’ai pas de remords, parce que cette femme, je le crois, méritait la peine qu’elle a subie. Je n’ai pas de remords, parce que si nous l’eussions laissée vivre, elle eût sans aucun doute continué son œuvre de destruction, mais cela ne veut pas dire, ami, que j’aie cette conviction que nous avions le droit de faire ce que nous avons fait. Peut-être tout sang versé veut-il une expiation. Elle a accompli la sienne ; peut-être à notre tour nous reste-t-il à accomplir la nôtre.
— Je l’ai quelquefois pensé comme vous, Athos, dit d’Artagnan.
— Elle avait un fils, cette femme ?
— Oui.
— En avez-vous quelquefois entendu parler ?
— Jamais.
— Il doit avoir vingt-trois ans, murmura Athos ; je pense souvent à ce jeune homme, d’Artagnan !
— C’est étrange ! Et moi je l’avais oublié !
Athos sourit mélancoliquement. » (chap. XVI)
Il l’avoue à moitié et plus tard même s’il s’écrase face à Porthos (qui a oublié) et à Aramis (pour qui ça « prête à discussion »), où seul Athos exprime des regrets de façon plus active, même si plus karmique que repentante.
« Athos se jeta sur le canon de la carabine et arrêta le coup qui allait partir.
— Que le diable vous emporte ! s’écria Aramis ; je le tenais si bien au bout de mon mousquet ; je lui eusse mis la balle en pleine poitrine.
— C’est bien assez d’avoir tué la mère, dit sourdement Athos.
— La mère était une scélérate qui nous avait tous frappés en nous ou dans ceux qui nous étaient chers.
— Oui, mais le fils ne nous a rien fait, lui. » (chap. LXVI)
« — Vous ? reprit Aramis. Dites-moi un peu ce que vous redoutez.
— Rien, dans le présent du moins, c’est vrai.
— Et dans le passé ? dit Porthos.
— Ah ! dans le passé, c’est autre chose, dit Athos avec un soupir ; dans le passé et dans l’avenir.
— Est-ce que vous craignez pour votre jeune Raoul ? demanda Aramis.
— Bon ! dit d’Artagnan, on n’est jamais tué à la première affaire.
— Ni à la seconde, dit Aramis.
— Ni à la troisième, dit Porthos. D’ailleurs, quand on est tué, on en revient, et la preuve c’est que nous voilà.
— Non, dit Athos, ce n’est pas Raoul non plus qui m’inquiète, car il se conduira, je l’espère, en gentilhomme, et s’il est tué, eh bien ! ce sera bravement ; mais tenez, si ce malheur lui arrivait, eh bien…
Athos passa la main sur son front pâle.
— Eh bien ? demanda Aramis.
— Eh bien ! je regarderais ce malheur comme une expiation.
— Ah ! ah ! dit d’Artagnan, je sais ce que vous voulez dire.
— Et moi aussi, dit Aramis ; mais il ne faut pas songer à cela, Athos ; le passé est passé.
— Je ne comprends pas, dit Porthos.
— L’affaire d’Armentières, dit tout bas d’Artagnan.
— L’affaire d’Armentières ? demanda celui-ci.
— Milady…
— Ah ! oui, dit Porthos, c’est vrai, je l’avais oubliée, moi.
Athos le regarda de son œil profond.
— Vous l’avez oubliée, vous, Porthos ? dit-il.
— Ma foi, oui ! dit Porthos, il y a longtemps de cela.
— La chose ne pèse donc point à votre conscience ?
— Ma foi, non, dit Porthos.
— Et à vous, Aramis ?
— Mais, j’y pense parfois, dit Aramis, comme à un des cas de conscience qui prêtent le plus à la discussion.
— Et à vous, d’Artagnan ?
— Moi, j’avoue que lorsque mon esprit s’arrête sur cette époque terrible, je n’ai de souvenirs que pour le corps glacé de cette pauvre Mme Bonacieux. Oui, oui, murmura-t-il, j’ai eu bien des fois des regrets pour la victime, jamais de remords pour son assassin.
Athos secoua la tête d’un air de doute.
— Songez, dit Aramis, que si vous admettez la justice divine et sa participation aux choses de ce monde, cette femme a été punie de par la volonté de Dieu. Nous avons été les instruments, voilà tout.
— Mais le libre arbitre, Aramis ?
— Que fait le juge ? il a son libre arbitre et il condamne sans crainte. Que fait le bourreau ? Il est maître de son bras, et cependant il frappe sans remords.
— Le bourreau… murmura Athos, et l’on vit qu’il s’arrêtait à un souvenir.
— Je sais que c’est effrayant, dit d’Artagnan, mais quand on pense que nous avons tué des Anglais, des Rochelois, des Espagnols, des Français même, qui ne nous avaient jamais fait d’autre mal que de nous coucher en joue et de nous manquer, qui n’avaient jamais eu d’autre tort que de croiser le fer avec nous et de ne pas arriver à la parade assez vite, je m’excuse pour ma part dans le meurtre de cette femme, parole d’honneur !
— Moi, dit Porthos, maintenant que vous m’en avez fait souvenir, Athos, je revois encore la scène comme si j’y étais : Milady était là, où vous êtes (Athos pâlit) ; moi j’étais à la place où se trouve d’Artagnan. J’avais au côté une épée qui coupait comme un damas ; Vous vous la rappelez, Aramis, car vous l’appeliez toujours Balizarde ?… Eh bien ! je vous jure à tous trois que s’il n’y avait pas eu là un bourreau de Béthune… Est-ce de Béthune ?… Oui, ma foi, de Béthune… j’eusse coupé le cou à cette scélérate, sans m’y reprendre, et même en m’y reprenant. C’était une méchante femme.
— Et puis, dit Aramis, avec ce ton d’insoucieuse philosophie qu’il avait pris depuis qu’il était d’église, et dans lequel il y avait bien plus d’athéisme que de confiance en Dieu, à quoi bon songer à cela ! ce qui est fait est fait. Nous nous confesserons de cette action à l’heure suprême, et Dieu saura bien mieux que nous si c’est un crime, une faute ou une action méritoire. M’en repentir, me direz-vous ? ma foi, non. Sur l’honneur et sur la croix, je ne me repens que parce qu’elle était femme.
— Le plus tranquillisant dans tout cela, dit d’Artagnan, c’est que de ce passé il ne reste aucune trace.
— Elle avait un fils, dit Athos.
— Ah ! oui, je le sais bien, dit d’Artagnan, et vous m’en avez parlé ; mais qui sait ce qu’il est devenu ? Mort le serpent, morte la couvée ! Croyez-vous que de Winter, son oncle, aura élevé ce serpenteau-là ? De Winter aura condamné le fils comme il a condamné la mère.
— Alors, dit Athos, malheur à de Winter, car l’enfant n’avait rien fait, lui.
— L’enfant est mort, ou le diable m’emporte ! dit Porthos. Il fait tant de brouillard dans cet affreux pays, à ce que dit d’Artagnan du moins… » (chap. XXXVIII)
C’est principalement en pointant que Mordaunt était un enfant innocent mais la dynamique elle-même me semblant très intéressante. Tout cela ajoute à une certaine texture, mais qui tente peut-être de réhausser encore plus la noblesse de nos héros : ah, ils regrettent la fougue justicière de leur jeunesse… Mais c’est au moins une réalisation des problèmes du premier livre.
Et c’est ça qui rend très naturelles des adaptations plus critiques, qui manifestent plus frontalement cette tension comme les bandes dessinées D’Artagnan, Journal d’un cadet de Nicolas Juncker (auquel j’ai en fait piqué l’apparence des mousquetaires tels que je les dessine et ce malgré le texte) et Milady de Winter d’Agnès Maupré.
Une autre dimension qui rajoute de la complexité, c’est qu’on n’a plus le cardinal Richelieu pour former un pôle du mal qui oriente tout l’échiquier moral de l’histoire. Mazarin est tellement médiocre qu’on en vient à louer Richelieu maintenant qu’il est mort et à reconnaître son génie. Et même si on voulait simplement être le paladin de la Reine, qu’est-ce que ça implique ? On n’a plus de vils mousquetaires du cardinal à combattre machinalement. Faut-il joindre Anne d’Autriche dans son alliance avec Mazarin ou les princes frondeurs dans une tentative de matérialiser la volonté supposée du roi retenu captif de ce gouvernement ?
Bon, Charles Ier est présenté comme un saint catholique, et on pourrait arguer qu’il y a un déplacement anglais où lui et Henriette manifestent la dernière branche de cette royauté sacrée qui fédère les compagnons contre la bureaucratie mazarine ou le totalitarisme puritain.
Ce qui nous amène au troisième et dernier volet de la main de Dumas : Le Vicomte de Bragelonne (publié de 1847 à 1850) se situe quinze ans supplémentaires après cela, et les sensations fortes de cape et d’épée de l’original se font encore moins sentir. Trois fois plus long que les Trois Mousquetaires ou Vingt Ans Après, si vous avez l’édition folio, vous sentirez passer le long tiers central d’intrigues de cour du tome II avec des personnages que vous confondrez volontiers. C’est le combat de deux d’entre eux que j’ai choisi d’illustrer comme je l’expliquerai dans un instant.
Le titre renvoie à Raoul, Vicomte de Bragelonne, qui voit sa fiancée Louise succomber aux charmes du roi Louis XIV, qui la pourchassait d’une cour fort peu courtoise et égoïste, profitant d’avoir envoyé Raoul en mission en Angleterre pour charmer sa dame. Le groupe de courtisan gravitant autour du roi et protégeant la liaison envenime l’animosité entre les quatre mousquetaires et la Couronne. Ils tentent différentes choses pour s’opposer au Roi, principalement des discours mélodramatiques sur le fait que cette vieille garde vaut mieux que la nouvelle génération, mais sans trop de succès, hormis le plan le plus spéctaculaire et dont on se rappelle le mieux de ce roman : l’homme au Masque de Fer. Dumas relaie cette légende : Aramis apprend l’existence d’un jumeau de Louis XIV, maintenu en captivité et qui ne peut sortir à l’air que le visage couvert. Devenu général des Jésuites, il tente avec l’aide d’un Porthos pas si naïf que cela de le placer sur le trône de France pour l’y manipuler. Cela échoue finalement, pour des raisons linguistiques, et le narrateur suit ses personnages jusqu’à la mort.
Porthos meurt dans un éboulement qu’il a déclenché en combattant les troupes du roi ; Raoul meurt dans une expédition coloniale en Algérie ; Athos de chagrin en apprenant le décès de son fils ; D’Artagnan dans une campagne de Louis XIV dans les pays-bas, ce qui est la mort du D’Artagnan historique. Seul subsiste Aramis, qui dans ce crépuscule immoral est même toléré malgré ses manigances dans les cercles du pouvoir sous un autre nom qui semble expier la faille linguistique de son plan. Le roman se conclut :
« Des quatre vaillants hommes dont nous avons raconté l’histoire, il ne restait plus qu’un seul corps : Dieu avait repris les âmes. » (Chap. CCLXVIII)
Aramis a explicitement vendu son âme.
Soyons honnête, Dumas a toujours joué assez librement avec l’histoire (Charles Ier serait un bon exemple) et dans Le Vicomte de Bragelonne il nous montre au mieux une caricature des dynamiques de cour des années 1660, invoquées surtout pour contraster avec la pseudo-chevalerie aventureuse des Trois Mousquetaires qui était encore brandie comme un remède aux intrigues politiques. Mais désormais, au contraire, dans un monde si déformé parle pouvoir, c’est difficile d’encore prétendre aux vertus de cette camaraderie guerrière.
La scène que j’ai choisi illustre à mon avis à merveille le regard que le roman porte sur toute la saga des Mousquetaires. Le duel est raconté au chapitre CIII, « Le Terrain de Dieu ». Après que Louis XIV ait refusé que Raoul marie Louise de la Vallière, De Wardes (le fils de l’amant de Milady que D’Artagnan avait remplacé dans son lit après lui avoir volé une lettre — elle reçoit ses amants dans le noir de par sa marque au fer rouge) De Wardes donc avait insulté D’Artagnan et les origines de Raoul, de ce qu’il ne connaîtrait pas sa mère. (c’est le fils illégitime d’Athos et de Madame de Chevreuse cf. Vingt Ans Après chap. XXII) D’Artagnan le prend à part pour discuter, où De Wardes rappelle à D’Artagnan ses péchés d’il y a 35 ans :
— Eh bien ! écoutez. Mon père aimait une femme, une femme noble ; cette femme aimait mon père.
D’Artagnan échangea un regard avec Athos.
De Wardes continua.
— M. d’Artagnan surprit des lettres qui indiquaient un rendez-vous, se substitua, sous un déguisement, à celui qui était attendu et abusa de l’obscurité.
— C’est vrai, dit d’Artagnan.
Un léger murmure se fit entendre parmi les assistants.
— Oui, j’ai commis cette mauvaise action. Vous auriez dû ajouter, Monsieur, puisque vous êtes si impartial, qu’à l’époque où se passa l’événement que vous me reprochez, je n’avais point encore vingt et un ans.
— L’action n’en est pas moins honteuse, dit de Wardes, et l’âge de raison suffit à un gentilhomme pour ne pas commettre une indélicatesse.
Un nouveau murmure se fit entendre, mais d’étonnement et presque de doute.
— C’était une supercherie honteuse, en effet, dit d’Artagnan, et je n’ai point attendu que M. de Wardes me la reprochât pour me la reprocher moi-même et bien amèrement. L’âge m’a fait plus raisonnable, plus probe surtout, et j’ai expié ce tort par de longs regrets. Mais j’en appelle à vous, Messieurs ; cela se passait en 1626, et c’était un temps, heureusement pour vous, vous ne savez cela que par tradition, et c’était un temps où l’amour n’était pas scrupuleux, où les consciences ne distillaient pas, comme aujourd’hui, le venin et la myrrhe. Nous étions de jeunes soldats toujours battants, toujours battus, toujours l’épée hors du fourreau ou tout au moins à moitié tirée, toujours entre deux morts ; la guerre nous faisait durs, et le cardinal nous faisait pressés. Enfin, je me suis repenti, et, il y a plus, je me repens encore, monsieur de Wardes.
— Oui, Monsieur, je comprends cela, car l’action comportait le repentir ; mais vous n’en avez pas moins causé la perte d’une femme. Celle dont vous parlez, voilée par sa honte, courbée sous son affront, celle dont vous parlez a fui, elle a quitté la France, et l’on n’a jamais su ce qu’elle était devenue…
La perspective morale du premier roman est clairement dénoncée : on s’interroge sur le déshonneur indu de Milady, en plus des crimes de D’Artagnan, qui invoque son jeune âge — il arrive en effet à Paris à 17 ans. Cependant, Milady était-elle si vieille ? Elle n’avait alors que 25 ans. Mordaunt n’en avait que 23. Athos tente une reprise de volée puisque le fils de feu le duc de Buckingham est encore dans la salle :
[…] C’était une femme de vingt-cinq ans, mince, pâle, blonde, qui s’était mariée en Angleterre.
— Mariée ? fit de Wardes.
— Ah ! vous ignoriez qu’elle fût mariée ? Vous voyez que nous sommes mieux instruits que vous, monsieur de Wardes. Savez-vous qu’on l’appelait habituellement Milady, sans ajouter aucun nom à cette qualification ?
— Oui, Monsieur, je sais cela.
— Mon Dieu ! murmura Buckingham.
— Eh bien ! cette femme, qui venait d’Angleterre, retourna en Angleterre, après avoir trois fois conspiré la mort de M. d’Artagnan. C’était justice, n’est-ce pas ? Je le veux bien, M. d’Artagnan l’avait insultée. Mais ce qui n’est plus justice, c’est qu’en Angleterre, par ses séductions, cette femme conquit un jeune homme qui était au service de lord de Winter, et que l’on nommait Felton. Vous pâlissez, milord de Buckingham ? vos yeux s’allument à la fois de colère et de douleur ? Alors, achevez le récit, milord, et dites à M. de Wardes quelle était cette femme qui mit le couteau à la main de l’assassin de votre père.
Un cri s’échappa de toutes les bouches. Le jeune duc passa un mouchoir sur son front inondé de sueur.
Un grand silence s’était fait parmi tous les assistants.
D’Artagnan espère cependant réconcilier tout le monde. En duelliste redouté, il pointe que ça ne peut pas se régler par l’épée, c’est démodé et c’est interdit et espère bien arracher des excuses à De Wardes pour avoir insulté l’ascendance de Raoul.
— Mais il me semble, dit de Wardes, que les paroles sont libres, quand on offre de les soutenir par tous les moyens qui sont à la disposition d’un galant homme.
— Ah ! Monsieur, quels sont les moyens, dites-moi, à l’aide desquels un galant homme peut soutenir une méchante parole ?
— Par l’épée.
— Vous manquez non-seulement de logique en disant cela, mais encore de religion et d’honneur ; vous exposez la vie de plusieurs hommes, sans parler de la vôtre, qui me paraît fort aventurée. Or, toute mode passe, Monsieur, et la mode est passée des rencontres, sans compter les édits de Sa Majesté qui défendent le duel. Donc, pour être conséquent avec vos idées de chevalerie, vous allez présenter vos excuses à M. Raoul de Bragelonne ; vous lui direz que vous regrettez d’avoir tenu un propos léger ; que la noblesse et la pureté de sa race sont écrites non-seulement dans son cœur, mais encore dans toutes les actions de sa vie. Vous allez faire cela, monsieur de Wardes, comme je l’ai fait tout à l’heure, moi, vieux capitaine, devant votre moustache d’enfant.
— Et si je ne le fais pas ? demanda de Wardes.
— Eh bien, il arrivera…
— Ce que vous croyez empêcher, dit de Wardes en riant ; il arrivera que votre logique de conciliation aboutira à une violation des défenses du roi.
— Non, Monsieur, dit tranquillement le capitaine, et vous êtes dans l’erreur.
— Qu’arrivera-t-il donc, alors ?
— Il arrivera que j’irai trouver le roi, avec qui je suis assez bien ; le roi, à qui j’ai eu le bonheur de rendre quelques services qui datent d’un temps où vous n’étiez pas encore né ; le roi, enfin, qui, sur ma demande, vient de m’envoyer un ordre en blanc pour M. Baisemeaux de Montlezun gouverneur de la Bastille, et que je dirai au roi : « Sire, un homme à insulté lâchement M. de Bragelonne dans la personne de sa mère. J’ai écrit le nom de cet homme sur la lettre de cachet que Votre Majesté a bien voulu me donner, de sorte que M. de Wardes est à la Bastille pour trois ans. »
De Wardes se soumet à la menace mais il explose : lui et Raoul seront pires ennemis que jamais, mais Raoul dit placidement qu’il n’a pas « un atome de fiel contre lui ». Par contre, Buckingham se battra volontiers contre De Wardes, vu qu’il n’est pas un citoyen français et soumis aux interdictions de duel, et, précaution supplémentaire :
Nous tirerons l’épée là-bas, sur le sable que couvre la marée, et qui, six heures par jour, est le territoire de la France, mais pendant six autres heures le territoire de Dieu.
— C’est bien, répliqua de Wardes ; j’accepte.
— Pardieu ! dit le duc, si vous me tuez, mon cher monsieur de Wardes, vous me rendrez, je vous en réponds, un signalé service.
— Je ferai ce que je pourrai pour vous être agréable, duc, dit de Wardes.
Ils chevauchent jusqu’à Calais, se demandent le plus poliment du monde s’ils vont bien, si ce banc de sable ira mieux que celui-là, pouet pouet, on se donne du milord, permettez que je tourne le dos à la mer, oh mais vous aurez le soleil dans les yeux, c’est fort galant mais ils se couche, c’est insupportable. Ils manifestent ensuite leur désir de se tuer l’un l’autre :
— Monsieur de Wardes, dit alors Buckingham, un dernier mot, s’il vous plaît… Je me bats contre vous, parce que je ne vous aime pas, parce que vous m’avez déchiré le cœur en raillant certaine passion que j’ai, que j’avoue en ce moment, et pour laquelle je serais très heureux de mourir. Vous êtes un méchant homme, monsieur de Wardes, et je veux faire tous mes efforts pour vous tuer ; car, je le sens, si vous ne mourez pas de ce coup, vous ferez dans l’avenir beaucoup de mal à mes amis. Voilà ce que j’avais à vous dire, monsieur de Wardes.
Et Buckingham salua.
— Et moi, milord, voici ce que j’ai à vous répondre : je ne vous haïssais pas ; mais, maintenant que vous m’avez deviné, je vous hais, et vais faire tout ce que je pourrai pour vous tuer.
Et de Wardes salua Buckingham.
Il y a encore une histoire d’amour que je n’ai pas mentionné, et qui conduit à un autre duel, mais bon. Ils croisent ensuite le fer alors que les lames de la mer submergent leur petite île puis eux-mêmes. Mais alors que De Wardes est mortellement blessé, et que la suite de Buckingham qui vient les secourir en barque veut le laisser mourir, le duc insiste pour qu’il soit sauvé et donne de l’argent pour qu’on prenne soin de lui. De la chevalerie entre ennemis mortels, à nouveau.
Mais à quoi bon ?
Le blanc-seing de Richelieu est un twist fabuleux, et grâce à lui, les mousquetaires avaient tué Milady hors de portée de la justice des hommes. Mais même ça fut en vain. Vingt ans après, Mordaunt revenait la venger contre des mousquetaires vaguement pénitents, inquiets que leur mort soit requise par le Ciel. Trente-cinq ans après, et ce malgré la lettre de cachet brandie par D’Artagnan pour obtenir la paix par la menace — un autre papier au trop grand pouvoir — le fils de Buckingham, tué à l’instigation de Milady, et le fils de De Wardes, son ancien amant, se battent sans raison, se tuent presque — mais ils sont très polis ! Ce duel n’a pas grande importance dans le schéma plus grand du roman, il ne fait que prolonger des querelles vieilles de trois décennies, sur les braises desquelles soufflent Louis XIV et ses proches pour assurer sa prise sur Louise. Cette pseudo-chevalerie où on sauve le Roi et la Reine malgré leurs vils conseillers ne marche pas quand le roi et la noblesse sont eux-mêmes corrompus. Tuer la vilaine femme ne suffit pas à arrêter les combats puisque ça n’a jamais été de sa faute. Ce n’est pas seulement un fossile dysfonctionnel d’une époque fictive : c’était aussi complètement vain.
Regardons de plus près le malheur de Raoul, qui donne son titre au roman. Quoique l’amour non-réciproque soit toujours triste, quels torts, véritablement, peut-on dénoncer dans ce qui se produit ? Louise ne l’aime plus. Ce n’est pas un crime ! Ce n’est même pas une faute. Ironie, Louis XIV éloigne même Raoul avant même qu’il ne commence à convoiter Louise. Certes le Roi de France mettant ses atouts dans la balance a quelque chose de déséquilibrant, et on pointe le cynisme du roi, qui la remplacera par madame de Montespan. (chap. CCXLVIII) Mais Louise serait-elle plus libre si elle était forcée à marier celui à qui elle est promise depuis sa plus tendre enfance, qui a le béguin pour elle depuis qu’elle a littéralement sept ans ? (Vingt Ans Après chap. XVII) Le chapitre CC du Vicomte, où Louise vient confesser son amour pour Louis à Raoul et demander son pardon et sa compréhension est intéressant. Raoul est techniquement noble, mais c’est uniquement de par la possibilité évidente qu’il a (et à laquelle il succombe parfois) d’être mesquin et cruel, par exemple :
La Vallière voulut tendre ses mains vers lui.
— Nous ne devons plus nous voir dans ce monde, dit-il.
Elle voulut s’écrier : il lui ferma la bouche avec la main. Elle baisa cette main et s’évanouit.
— Olivain, dit Raoul, prenez cette jeune dame et la portez dans sa chaise, qui attend à la porte.
Olivain la souleva. Raoul fit un mouvement pour se précipiter vers La Vallière, pour lui donner le premier et le dernier baiser ; puis, s’arrêtant tout à coup :
— Non, dit-il, ce bien n’est pas à moi. Je ne suis pas le roi de France, pour voler !
Et il rentra dans sa chambre, tandis que le laquais emportait La Vallière toujours évanouie.
Quelle noblesse de ne pas… Avoir embrassé une femme inconsciente ? Cette miséricorde n’existe que face à l’opportunité de la violence. Et même l’absolution qu’il donne semble heurter Louise comme une moquerie.
Et quels remèdes nos héros proposent-ils à ce méfait qui n’en est pas un ?
Athos va faire un long discours mélodramatique sur le fait que la noblesse se perd et s’il était vraiment un roi noble il aurait l’abnégation de laisser son fils Raoul fricoter avec Louise, il finit par briser sa vieille épée de famille sur son genou après avoir insulté très poliment le roi. (« Roi et Noblesse », chap. CXCVII) Il est embastillé. (chap. CCI et suivants)
D’Artagnan va se porter garant d’Athos et ajoute son impudence à la sienne, allant jusqu’à menacer de se suicider. Ça ne consolera pas Raoul mais ça fait libérer Athos. (chap. CCIII) Face aux médisances de De Wardes, comme on l’a vu, il pense que la diplomatie ou une lettre de cachet, le pouvoir d’emprisonner les gens sans justification, va permettre d’aplanir les querelles, mais ça ne le fait que peu. Ça marche relativement bien pour maintenir son jumeau secret à l’écart, mais pour le reste…
Porthos est le plus ancré dans la tradition des mousquetaires. Apprenant que Raoul a un différent avec quelqu’un, il se propose de se faire l’entremetteur de leur duel, sans réaliser bien sûr que c’est le Roi. Il lui parle de sa manière d’arranger les querelles, se disant plus doux que D’Artagnan, et Raoul est presque déçu, s’attendant à de la violence :
— « Monsieur, lui dis-je, à présent que vous êtes convaincu de l’offense, nous sommes assurés de la réparation. Entre mon ami et vous, c’est désormais un échange de gracieux procédés. En conséquence, je suis chargé de vous donner la longueur de l’épée de mon ami. »
— Hein ? fit Raoul.
— Attendez donc !… « La longueur de l’épée de mon ami. J’ai un cheval en bas ; mon ami est à tel endroit, qui attend impatiemment votre aimable présence ; je vous emmène ; nous prenons votre témoin en passant, l’affaire est arrangée. »
— Et, dit Raoul pâle de dépit, vous réconciliez les deux adversaires sur le terrain ?
— Plaît-il ? interrompit Porthos. Réconcilier ? pour quoi faire ?
— Vous dites que l’affaire est arrangée…
— Sans doute, puisque mon ami attend.
— Eh bien, quoi ! s’il attend…
— Eh bien, s’il attend, c’est pour se délier les jambes. L’adversaire, au contraire, est encore tout roide du cheval ; on s’aligne, et mon ami tue l’adversaire. C’est fini.
Mais cette tactique bien sûr s’effondre ici parce qu’on ne peut pas défier le Roi en duel : « Oh ! roi perfide ! roi traître ! je ne puis t’atteindre ! Je ne le veux pas ! Les rois sont des personnes sacrées ». Raoul envoie donc Porthos intimider son complice lui confiant seulement de faire allusion au portait (de Louise, commandé par Louis), à la trappe (entrée secrète reliant l’appartemement de Saint-Aignan, où se trouvait le portrait, et celui de Louise) et au déménagement (de Saint-Aignan, qui avait permis l’installation de ce dispositif). Dans une scène hilarante, Porthos tourmente Saint-Aignan par ces trois mots sans avoir réellement l’idée de ce à quoi ils renvoient, mais il défend l’offense à Raoul que cacheraient ces mots avec une loyauté infernale. (chap. CXCIV)
Aramis est le seul à aller jusqu’au bout. Si le Roi est un obstacle, eh bien, il le remplacera par son frère jumeau secret — malheureusement, retenu en prison, il ne parle pas espagnol. Cela fait tout capoter, et ils doivent avec Porthos se réfugier à Belle-Isle-En-Mer, où le loyal compagnon trouvera la mort (CCLVI) tandis qu’Aramis s’échappe grâce à ses astuces jésuites. (CCLVII) On pourrait voir dans Porthos une loyauté aveugle et naïve, mais comme le découvre D’Artagnan à la lecture de son testament il ne se faisait pas tant d’illusions sur les motivations ou le destin d’Aramis. (CCLXI)
Et en tant que tel ce combat sur le Terrain de Dieu est très représentatif de l’essence de ce roman, une dénonciation cruelle de cette chevalerie qui se croit honorable par une interprétation littéraliste de l’honneur (« je ne suis techniquement pas sur le sol de France, regardez, j’ai de l’eau autour des pieds, ce duel n’est donc pas illégal ») tout en étant le combat le plus mémorable de toute la trilogie de par son décor : la marée montante qui ne se soucie pas des lames des duellistes, le sel et le sable grimpant dans leurs plaies. La mer a été l’excuse de ces hommes et elle sera leur perte.
Malgré ces quelques éléments critiques dans le texte, je ne vais pas prétendre que le livre a une morale magnifique. On peut encore choisir de croire au bien-fondé des rodomontades de ces paladins, et si on est entraînés par l’action et qu’on ne compatit qu’avec ceux qui ont un projecteur dessus, on sera aussi aveugle aux tourments de Louise qu’on le fut à ceux de Milady. Dans l’exemplaire qui subit ma première lecture en 2011, je retrouve une annotation, qui se moquait du mélodrame, mais tout de même misogyne, où je maudissais cette amante inconstante qui cessait d’aimer Raoul. Pourtant, objectivement le romancier ébauche un peu ses souffrances pour nous les rendre crédible, la relation avec Louis est présentée avec empathie et érotisme (enfin si baiser la paume des mains vous suffit niveau érotisme). La versatilité tient plus du feuilleton que des discours moralisateurs adjoints à la tragédie. Reste, tout ça me passait sous le nez. Je pourrais comme d’Artagnan invoquer mon jeune âge alors, mais ce sera la lecture de la plupart des lecteurs : Raoul donne son nom au livre, on doit bien compatir avec ?

Le discours sur la chevalerie a une ambivalence similaire. On peut s’asseoir sur l’élan des deux livres précédents et juste croire que la chvalrie est possible, qu’il y a juste quelques complexités, quelques obstacles de plus. Mais tout discours sur ce mirage qu’est la « vraie chevalerie » parle aussi de l’abolition de ses versions mondaines et corrompues. On parlait récemment d’un des chefs d’œuvres littéraires du moyen âge occidental, La Queste Del Saint Graal (~1215-1230), où l’on voit les prouesses et les tournois délaissés pour une chevalerie « celestielle » : pacifiste, spirituelle et pénitente.
Le vrai temps de chevalerie a toujours une odeur de jadis, ou viendra enfin quand on abolira les complexités du Siècle. Saint-Aignan dit avec humour à Louis XVI que « M. de Bragelonne appartient à cette race sévère qui joue les héros romains. » (Vicomte de Bragelonne chap. CCIII). Athos mentionne à D’Artagnan une épée donnée par François Ier à un de ses ancêtres en remerciement de lui en avoir prêté une quand il avait brisé la sienne à Marignan. Il évoque ainsi l’ère de Bayard : « C’était le temps des géants, dit Athos. Nous sommes des nains, nous autres, à côté de ces hommes-là. » (Vingt Ans Après, chap. XVI) Et la même dynamique a lieu quand Athos, Porthos, Aramis et D’Artagnan se rappellent de leur jeunesse : c’était le temps où on était vraiment des sauvages assoiffés de duels sanglants de nobles chvaliers. Quand Dumas étale le plus ouvertement son idéologie nobiliaire, il distingue bien l’idéal de la réalité, et c’est l’idéal qu’il faut suivre, par exemple quand Athos amène Raoul à Saint-Denis pour prêter serment sur les mânes des rois défunts :
Raoul, sachez distinguer toujours le roi de la royauté : le roi n’est qu’un homme, la royauté, c’est l’esprit de Dieu. Quand vous serez en doute de savoir qui vous devez servir, abandonnez l’apparence matérielle pour le principe invisible. Car le principe invisible est tout. Seulement, Dieu a voulu rendre ce principe palpable en l’incarnant dans un homme. Raoul, il me semble que je vois votre avenir comme à travers un nuage. Il est meilleur que le nôtre, je le crois. Tout au contraire de nous, qui avons eu un ministre sans roi, vous aurez, vous, un roi sans ministre. Vous pourrez donc servir, aimer et respecter le roi. Si ce roi est un tyran, car la toute-puissance a son vertige qui la pousse à la tyrannie, servez, aimez et respectez la royauté, c’est-à-dire la chose infaillible, c’est-à-dire l’esprit de Dieu sur la terre, c’est-à-dire cette étincelle céleste qui fait la poussière si grande et si sainte que, nous autres gentilshommes de haut lieu cependant, nous sommes aussi peu de chose devant ce corps étendu sur la dernière marche de cet escalier, que ce corps lui-même devant le trône du Seigneur.
J’espère que le roi sera pas trop tyrannique, et surtout pas de la pire des tyrannies, celle où il te vole ta copine juste parce qu’elle veut sortir avec lui.
Et quand l’idéal n’est pas à la hauteur, Athos brise son épée et renie le serment.
Comme extraits audio pour illustrer notre générique avant qu’on discute de La Queste Del Saint Graal, Antoine a choisi, en plus d’un extrait splendide de C’est Pas Sorcier et l’obligatoire Kaamelott, une réplique de Luke dans le dernier Star Wars, The Last Jedi qui cadre très bien avec l’esprit de la Queste :
It is time for the Jedi… to end.
(traduit « Il est temps pour les Jedi… D’en finir. »)
Beaucoup de gens ont détesté le traitement de Luke dans ce film, ou en tout cas ont bruyamment manifesté qu’ils avaient détesté cela, notamment qu’il dise que les Jedi n’ont jamais été si fabuleux que cela. J’en ai déjà un peu parlé, notamment sur le versant aristocratique. Mais franchement ? Ce n’est pas neuf qu’une histoire de chevalerie parle de la fin de la chevalerie comme unique rédemption pour celle-ci parce qu’elle avait précédemment été mal racontée. De même que Dumas croyait probablement sa hype nobiliaire, tout en livrant de nombreux éléments très préoccupants dans Les Trois Mousquetaires, les épisodes I à III de Star Wars présentaient un portrait plus qu’ambigu des Jedi, des manipulateurs politiques qui se servent de leurs pouvoirs psychiques pour asseoir leur autorité, allant jusqu’à commander des armées, et qui se sont tant immiscés dans les échelons de la République que les remplacer par un Seigneur Sith ne demanda que peu d’efforts. La complexité des intrigues politiques est certainement voulue à un certain degré — sans présumer du génie de George Lucas — mais une grande part de l’ambivalence vient de ce qu’il enchaînait tout ce qui pouvait avoir l’air cool, avoir l’air classe : des combats, boum, des intrigues politiques, des vaisseaux qui s’écrasent, des clones, oh une armée de clones, une course de pods, là, oh ils pourraient libérer ce gosse de l’esclavage (bon pas sa famille) parce que ce serait le messie Jedi et, oh, oh, cet arrachement pourrait être un arc émotionnel qui le pousse vers les ténèbres, oh, et ce serait très cool et classe si c’était en plus des paladins de vertu et de sagesse, mais malheureusement ça demande aussi qu’ils se comportent comme tel. Quand les mousquetaires paient le bourreau de Milady « voici le prix de l’exécution ; que l’on voie bien que nous agissons en juges » et que le bourreau jette la bourse à l’eau afin que « cette femme sache que je n’accomplis pas mon métier, mais mon devoir » (LXVI) c’est sans doute très dramatique.
Et ça ne tâche pas leur moralité, tant qu’on n’y pense pas.
Mais pour que la chevauchée continue, il faut qu’un personnage se retourne et pointe ce qu’il s’est réellement passé, afin que le chevaleresque signifie à nouveau quelque chose. Dumas a partiellement fait ça, et ses mousquetaires dès lors, nous ont moins l’air de géants, certes, mais on voit bien plus clair quand on descend de ces épaules fictives.
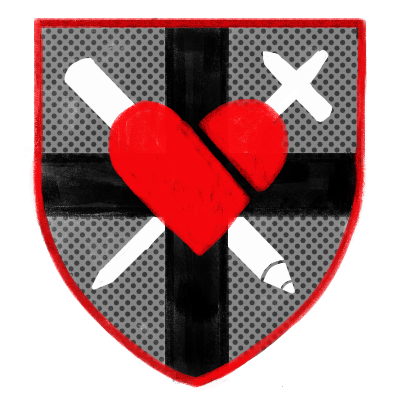

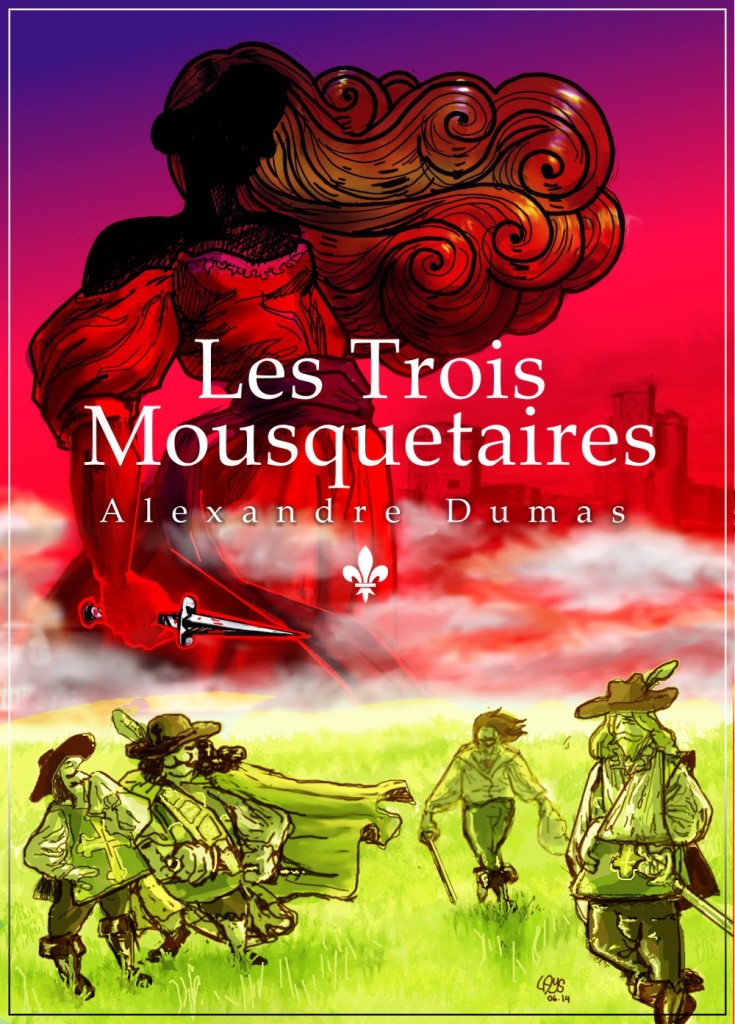
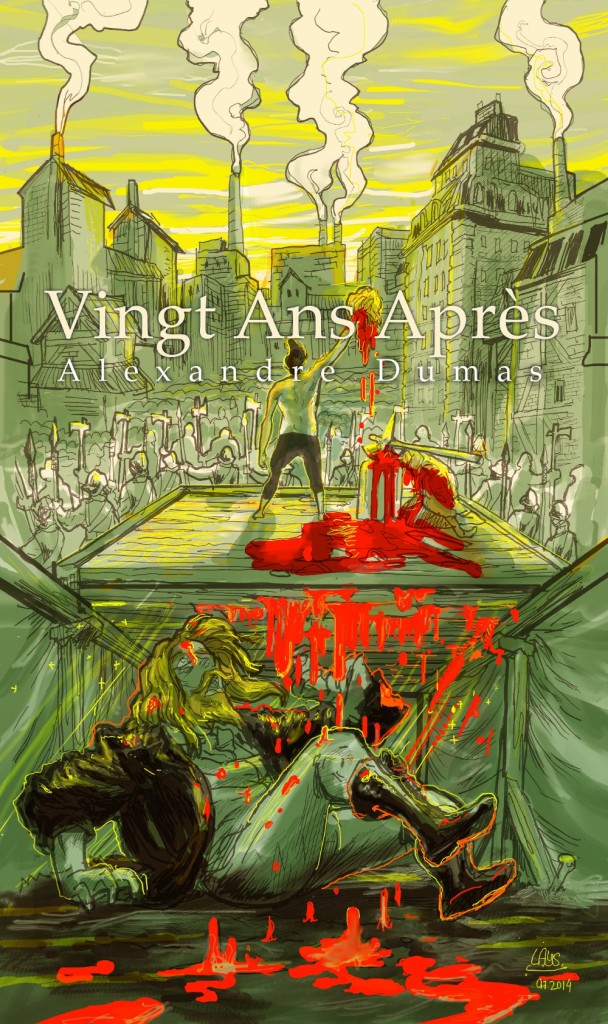




![Le_Vicomte_de_Bragelonne_par_[...]Dumas_Alexandre_bpt6k6570978d (1)](http://laysfarra.com/wp-content/uploads/2018/08/Le_Vicomte_de_Bragelonne_par_...Dumas_Alexandre_bpt6k6570978d-1-617x1024.jpeg)

Laisser un commentaire